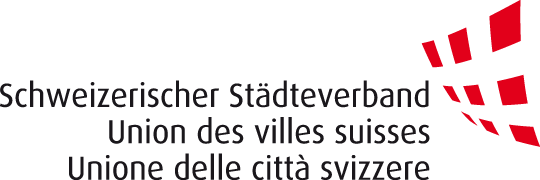Une politique des agglomérations diversifiée renforce la Suisse urbaine
Monika Litscher, vice-directrice de l’Union des villes suisses
De nos jours, les villes et communes d’agglomération sont des fournisseurs de services qui contribuent de manière décisive à la qualité de vie, à la prospérité et au progrès de la Suisse. Pour que ces agglomérations restent attrayantes et deviennent durablement résilientes, il faut toujours concevoir les processus territoriaux en gardant à l’esprit les défis écologiques, économiques et sociaux. Cette tâche extrêmement complexe, qui est en même temps une tâche stratégique de la Confédération, ne peut être résolue que sur le mode de la coopération et de la transversalité: la politique urbaine a besoin pour ses activités sur le terrain de soutien, de ressources et de connaissances, et la Confédération n’atteint ses objectifs qu’à travers des projets communaux. L’application systématique de l’article 50 de la Constitution fédérale et de la prise en compte des villes et des agglomérations que celui-ci exige est importante et particulièrement urgente.
Les échelons de l’État réalisent tous ensemble les objectifs nationaux
Cela vaut aussi pour les objectifs de la Stratégie pour le développement durable 2030 formulés par la Confédération. L’ancien président de l’Union des villes suisses Kurt Fluri a tout récemment demandé à nouveau dans une interpellation ce qu’il en était de l’ancrage de ces objectifs dans la politique des agglomérations et du soutien apporté aux villes et aux communes d’agglomération par la Confédération pour leur mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2030. Certes, le Conseil fédéral a reconnu l’importance des trois échelons de l’État pour la maîtrise des priorités thématiques – «consommation et production», «climat, énergie et biodiversité» et «égalité des chances et cohésion sociale». Mais au lieu de proposer de nouvelles voies concrètes pour une cohabitation entre société, environnement et territoire, il s’est contenté de renvoyer à des activités existantes, à l’évaluation en cours de l’actuelle Politique des agglomérations 2016+ et à la réponse au postulat en suspens du conseiller national et membre du comité de l’Union des villes suisses Philipp Kutter, qui n’a du reste pas encore été donnée.
L’ambitieux programme: le Programme en faveur du trafic d’agglomération
La politique des agglomérations est fréquemment assimilée au Programme en faveur du trafic d’agglomération (PTA), qui prévoit que la Confédération apporte aux agglomérations un soutien financier pour le développement des transports et l’urbanisation. Ce programme ambitieux, qui en est aujourd’hui à sa quatrième génération, constitue pour les villes et les agglomérations une mesure très importante pour développer l’infrastructure de transport de manière coordonnée (cf. la réponse à la consultation de l’Union des villes suisses). Ce soutien programmatique est nécessaire pour que les agglomérations atteignent leurs objectifs et puissent rendre possible une mobilité efficiente en termes de surface, sûre et économe en ressources. Il est réjouissant de constater que le programme prend explicitement en compte les transports publics, le vélo et la marche à pied. Un de ses défis réside dans la garantie de son financement à moyen et long terme: en effet, du fait de la décarbonation des voitures et de l’accroissement de l’électromobilité, les recettes générées par les taxes sur les huiles minérales diminuent à vue d’œil. La caisse du PTA, le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération FORTA, doit donc être alimentée par de nouveaux moyens financiers. Du point de vue des villes, il est également souhaitable que pour le financement du programme, le degré de financement possible de la contribution fédérale atteigne enfin vraiment les 50 % maximaux.
Le Programme en faveur du trafic d’agglomération ne pourra déployer ses effets dans le sens d’une évolution de la mobilité de qualité qu’en conjonction avec une urbanisation, un développement des centres et des espaces libres durables. Cela concerne les territoires urbains à l’intérieur des localités et les liaisons entre les communes d’agglomération, car les déplacements des pendulaires sont justement majoritairement réalisés avec la voiture, le mode de transport le plus inefficace en termes de surface. Il n’est souvent pas facile d’opter pour un mode de transport durable, et cela ne va pas non plus de soi. Du point de vue du pilotage politique, il serait indiqué de développer sur mesure et de manière ciblée les entités responsables établies dans ce Programme en faveur du trafic d’agglomération et organisées à l’échelle régionale pour qu’elles s’étendent à d’autres domaines politiques et transversaux.
Le petit mandat doté d’une force socioterritoriale: le Réseau Quartiers Vivants
L’échelon local, les espaces publics et le développement de quartier jouent un rôle important dans la conception des transformations urbaines. Le «Réseau Quartiers Vivants» en fait la démonstration magistrale. Une mise en réseau simple permet à des spécialistes de toute la Suisse travaillant à l’échelle des espaces socioterritoriaux d’échanger régulièrement sur des sujets d’actualité et de s’enrichir mutuellement par leurs expériences de la participation, leurs laboratoires du réel et du fait que leurs quartiers sont une force miniature. Ces offres et possibilités d’interaction facilement accessibles au niveau du quartier renforcent la cohésion sociale dans les agglomérations, car elles peuvent être vécues au jour le jour et dans l’espace public proche et sont importantes. Il s’agit de les créer, de les reconnaître, de les utiliser et de les développer.
Une définition claire de la participation est un pilier important du succès. Cela permet de renforcer les démocraties locales, d’entretenir les relations entre administration, politique et population, d’encourager l’identification avec le quartier, la ville et l’agglomération. Les connaissances pratiques débouchent souvent sur de nouvelles idées et renforcent la confiance envers les institutions et la démocratie en général.
Dans l’idéal, ces mesures sont dès à présent inscrites et renforcées dans le pilotage de la planification, des budgets et de la politique de la prochaine politique des agglomérations. Du point de vue des villes, un élargissement serait souhaitable, de sorte que les connaissances acquises dans le réseau puissent être rendues de manière ciblée tangibles pour la politique et la pratique. En effet, les histoires de réussite ne déploieront leurs effets dans la politique, l’économie et la société civile et ne pourront être développées sur un mode cocréatif que si elles sont diffusées et analysées.
Des agglomérations multiples et diverses: «pareilles, mais différentes»
Les programmes et projets de la politique des agglomérations se déclinent à différents niveaux. Ils s’engagent tous à atteindre les objectifs, toujours actuels, à savoir: une haute qualité de vie, une attractivité élevée du site, une urbanisation de qualité et une coopération efficace. Leurs différents points forts s’inscrivent dans le cadre d’un développement territorial cohérent qui se propose de penser la cohésion sociale en même temps que les défis territoriaux. Et c’est bien ainsi, car il n’y a pas une recette miracle pour la manière de procéder, les besoins ni la gouvernance urbaine de toutes les agglomérations. Sachant que les défis sont communs, les chances offertes sont néanmoins similaires. Pour être exploitées, il faudra une planification spécifique, une politique concrète sur le terrain et un soupçon de plaisir à expérimenter et elles pourront conjointement – et peut-être avec une meilleure gestion – contribuer à une politique des agglomérations forte – dans l’intérêt des agglomérations!