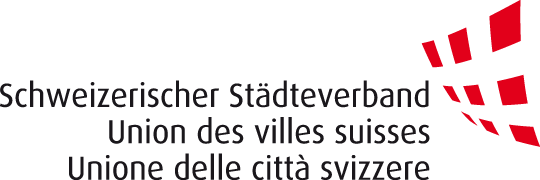Transformer les espaces consacrés au transport en espaces de vie: un besoin unanime de la population urbaine
Les villes sont traditionnellement des lieux de commerce, de rencontre et d’échange. La mobilité des personnes, des informations et des biens en est une condition préalable et un moteur du développement urbain. Les besoins en matière de mobilité évoluent avec la société. Nous sommes aujourd’hui plus mobiles que jamais, mais l’espace est limité. Les besoins croissants de mobilité doivent donc être compatibles avec tous les aspects de la vie dans un espace de plus en plus densément peuplé. La prise de position de l’UVS «Pour une mobilité urbaine efficace et respectueuse de l’environnement et de la société» montre les priorités actuelles des villes en matière de politique des transports et les orientations qu’elles entendent encore renforcer à l’avenir. L’objectif est de promouvoir et de développer une mobilité efficace en termes d’utilisation de l’espace, notamment la mobilité active (marche et vélo), les transports publics ainsi que les offres de mobilité partagée (autopartage, vélopartage, etc.). En raison de sa consommation d’espace comparativement élevée et de son impact négatif sur l’environnement, le transport individuel motorisé (TIM) ne doit jouer qu’un rôle subsidiaire. Une telle priorisation est impérative au regard de la croissance démographique dans les villes et du manque de place. Un développement vers l’intérieur de qualité et une mobilité efficace en termes d’utilisation de l’espace sont indissociables d’un développement urbain durable. Des mesures telles qu’une réduction de la vitesse, un élargissement des voies réservées aux piétons et aux cyclistes, une végétalisation accrue et la désimperméabilisation des sols sont essentielles pour garantir une qualité de vie et d’espace libre élevée dans l’espace urbain.
Dans le cadre de la planification ordinaire du trafic, chaque mètre carré de surface routière fait l’objet de négociations et de luttes acharnées. Les villes doivent faire face à de fortes résistances si elles veulent par exemple aménager des pistes cyclables sûres et doivent en contrepartie supprimer quelques places de stationnement. Dans le débat public, des voix s’élèvent parfois pour reprocher aux villes de mener une politique des transports idéologique, qui n’est pas en ligne avec les besoins de la population. La vaste enquête «La mobilité dans les villes suisses» réalisée par l’institut de recherche gfs.bern sur mandat de la Conférence des villes pour la mobilité et de dix-sept villes et communes d’agglomération participantes montre au contraire que la majorité des personnes interrogées est satisfaite de la situation des transports. À ce jour, aucune autre enquête ne fournit des données aussi solides sur le comportement de mobilité et l’attitude de la population face à la politique des transports dans les villes suisses. En effet, ce sondage se distingue par sa large couverture géographique et se fonde sur un échantillon représentatif de plus de 15 000 répondant·e·s.
Des réponses claires à la question cruciale de la politique des transports
Le fait que la politique des transports des villes soit soutenue par une grande majorité de la population urbaine se manifeste de façon exemplaire dans la question des préférences en matière d’allocation des surfaces. Souvent, il n’est pas possible d’augmenter la surface pour un moyen de transport sans grignoter la surface disponible pour un autre moyen. Les répondants devaient par exemple indiquer s’ils préféraient beaucoup d’espace pour le transport individuel motorisé et les places de stationnement, au détriment de l’espace destiné au trafic cycliste ou inversement. La même comparaison entre le transport individuel motorisé versus beaucoup de place pour les piétons, beaucoup d’espace public libre sans trafic ou beaucoup d’espace pour les transports publics était proposée dans ce bloc de questions. Sur la question de l’allocation des surfaces, les résultats sont sans équivoque: entre 59 % et 79 % des personnes interrogées souhaitent réduire la place accordée au transport individuel motorisé au profit du vélo, de la marche, des transports publics et des zones sans trafic.
Ce constat s’impose avec une étonnante constance dans toutes les villes, de Sion à Schaffhouse en passant par Bâle. C’est à Berne que l’opposition à un vaste espace dédié aux TIM est la plus prononcée: plus de 75 % des répondant·e·s se déclarent favorables à des utilisations autres que le transport individuel motorisé. Ce qui frappe, c’est que cette tendance se retrouve dans l’ensemble des villes étudiées, malgré des différences notables dans les habitudes de mobilité. À Berne, seuls 15 % des personnes interrogées déclarent utiliser régulièrement leur voiture pour se rendre au travail ou à l’école, contre 51 % à Sion. Les habitantes et habitants des villes semblent donc relativement unanimes sur les solutions à mettre en œuvre pour optimiser les infrastructures de transport, quel que soit leur mode de déplacement actuel. Compte tenu de la rareté de l’espace urbain et des réponses claires, le transport individuel motorisé doit être évité autant que possible, transféré vers d’autres moyens de transport, géré de manière compatible et mis en réseau. Une réduction du transport individuel motorisé permet de désengorger les routes. L’enquête gfs montre que les embouteillages, un système de transport saturé et les perturbations du trafic sont les causes les plus fréquentes de l’insatisfaction vis-à-vis de la situation de mobilité, suivis par le manque de places de stationnement. Il n’est pas étonnant que cette insatisfaction soit la plus élevée dans les villes où la voiture joue un rôle majeur. Mais il semble aussi que de nombreuses personnes qui se déplacent régulièrement en voiture estiment que le développement des infrastructures pour le TIM n’est, dans la plupart des cas, pas la bonne solution. En effet, si 44 % des personnes interrogées se plaignent d’un manque de places de stationnement, elles ne sont que 24 % à en souhaiter davantage dans l’espace public ou dans les parkings couverts lorsqu’on leur demande de classer les mesures de politique des transports par ordre de priorité. Ce souhait arrive donc en dernière position parmi les priorités exprimées par la population urbaine en matière de politique des transports.
Plus d’espaces verts: meilleure qualité de séjour et adaptation au climat
En raison du changement climatique, les villes s’intéressent de plus en plus à la façon d’aménager les espaces routiers pour réduire les températures élevées dans les îlots de chaleur urbains. L’enquête gfs montre que la population accorde une grande importance à la présence d’espaces verts le long des routes. Ce souhait arrive systématiquement en tête lorsque les personnes interrogées doivent indiquer les mesures de politique des transports qui devraient bénéficier de davantage d’investissements à l’avenir. Parmi les autres priorités fortes figurent le développement des infrastructures cyclables et la création d’espaces urbains agréables, propices au bien-être. Là encore, il s’agit d’un appel clair à transformer les espaces dédiés aux transports en espaces de vie offrant une qualité de séjour élevée et des conditions favorables à la mobilité active – une orientation qui correspond pleinement aux objectifs de l’Union des villes suisses, dans un contexte où le développement urbain vers l’intérieur est une nécessité.
Les zones de rencontre et la limitation de la vitesse à 30 km/h sont des modèles de réussite largement reconnus
Les zones de rencontre (où la priorité est donnée aux piétons et la vitesse limitée à 20 km/h ainsi que la limitation de vitesse à 30 km/h constituent des modèles de réussite dans les villes. Ces mesures jouent un rôle clé dans la création d’espaces routiers sûrs et agréables pour l’ensemble des usager·ère·s de la route. Elles contribuent à la réduction du bruit, à l’amélioration de la qualité de séjour et à la fluidité du trafic. Pourtant, la limitation à 30 km/h sur les routes principales fait actuellement l’objet de remises en question croissantes à l’échelle fédérale et dans certains cantons – en dépit de ses effets positifs largement documentés. L’enquête gfs montre que les zones de rencontre et la limitation de vitesse à 30 km/h répondent à un fort besoin de la population urbaine: près de 80 % des personnes interrogées habitant près d’une route où la vitesse est limitée à 30 km/h ou d’une zone de rencontre (20 km/h) considèrent que la vitesse en vigueur est tout juste acceptable. En revanche, entre un tiers et la moitié des personnes interrogées habitant près de routes où la vitesse est limitée à 50 km/h souhaitent une réduction de la vitesse. Face aux besoins évidents de la population, les villes doivent se défendre avec véhémence contre toute atteinte à ces acquis.
Potentiel de la mobilité active et partagée
La marche à pied est sans conteste le mode de déplacement le plus sain, le plus écologique et l’un des plus gratifiants. Et son importance pourrait encore augmenter: selon l’enquête gfs, 67 % des personnes interrogées se disent prêtes à marcher davantage à l’avenir. Les villes gagneraient à réfléchir encore plus intensivement aux moyens de valoriser ce potentiel. Les bénéfices sont multiples: sécurité routière, revalorisation des espaces routiers et adaptation de ceux-ci au changement climatique. L’étude révèle également un important potentiel inexploité dans le domaine du vélo, de nombreuses personnes restant toutefois freinées par le manque de sécurité: une personne sur cinq déclare ainsi renoncer à ce mode de transport parce qu’elle le juge trop dangereux.
Enfin, les offres de mobilité partagée (shared mobility) représentent par ailleurs un levier essentiel pour une mobilité urbaine efficace et économe en espace. L’enquête montre que les vélos partagés et e-bikes en libre-service prennent une place croissante, notamment dans les villes où l’offre est bien développée. À Berne, par exemple, 38 % des personnes interrogées déclarent avoir déjà utilisé un service de vélos en libre-service. L’intégration de ces nouvelles offres de mobilité dans le système de transport urbain, ainsi que leur mise en réseau avec les modes de transport classiques doivent être poursuivies activement.