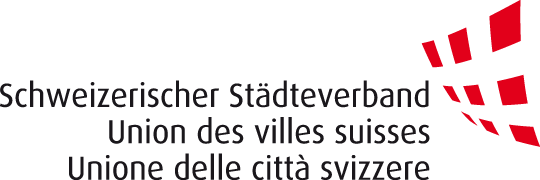Des habitats et des environnements de vie adaptés aux personnes âgées
Prof. Valérie Hugentobler, Prof. à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO), sociologue et experte en politique sociale et de la vieillesse.
La cinquième édition du Age Report, dédiée au thème du voisinage, relève qu’en Suisse la majorité des personnes âgées vivent de manière autonome chez elles et apprécient leur logement. Lorsqu’elles sont fragilisées, c’est bien souvent le soutien de leurs proches et des services d’aide et de soins à domicile, mais aussi parfois des voisins, qui leur permettent de rester vivre à domicile. L’étude revient sur la manière dont l’environnement social peut influencer les conditions de vie de cette population vieillissante, pour qui les besoins diffèrent significativement de ceux d’autres groupes d’âge. Les personnes âgées expriment en effet des besoins spécifiques qui vont au-delà de la seule accessibilité physique : elles demandent des environnements sûrs, lisibles, proches des services essentiels, mais aussi favorables aux liens sociaux. Pour qu’elles puissent vivre de manière autonome jusqu’à un âge avancé, il est nécessaire de garantir l’accès à un logement adapté et accessible financièrement, à la mobilité et à un voisinage soutenant. Cela implique de dépasser la vision médicalisée du vieillissement, pour promouvoir une participation active à la société.
Des logements appréciés mais peu adaptés
De manière générale, les logements restent à l’heure actuelle peu adaptés au vieillissement, seul un tiers d’entre eux étant considérés comme dénués d’obstacles. Souvent construits avant la mise en place de normes spécifiques, ils n’ont que peu fait l’objet d’adaptation au vieillissement depuis. Les personnes âgées qui ont fait le choix de déménager dans les cinq dernières années ont généralement opté pour un logement adapté, dans une construction souvent récente. Mais la mobilité résidentielle reste très faible chez les personnes retraitées, même si l’on constate une volonté d’autodétermination qui se traduit par la recherche de formes d’habitat diversifiées. L’émergence des logements accompagnés, des colocations entre seniors ou encore des habitats intergénérationnels est ainsi observée. Ces modèles favorisent l’autonomie tout en réduisant l’isolement. Toutefois, l’accessibilité financière reste un frein majeur à la mobilité résidentielle, en particulier pour les personnes âgées à faibles ressources, en particulier les femmes vivant seules.
Les composantes d’un environnement résidentiel de qualité
L’environnement résidentiel joue un rôle crucial dans l’appréciation de l’habitat. Les personnes âgées sont sensibles à la qualité du voisinage, à la tranquillité, à la présence d’espaces verts et des infrastructures, mais aussi à la possibilité d’interagir avec d’autres générations. En ville, la proximité des commerces, des services de santé ou encore des transports publics est fortement appréciée. En revanche, les nuisances sonores sont plus souvent mentionnées qu’en milieu rural, ainsi qu’un sentiment d’étrangeté au monde. Certaines personnes ont parfois la sensation de ne plus reconnaître le quartier dans lequel elles vivent depuis longtemps. Ce sentiment, souvent lié à un développement urbanistique rapide, peut générer un sentiment de perte de repères.
Le quartier comme espace de proximité et de soutien
Dans un contexte de recentrement des activités sur la sphère privée avec l’avancée en âge et face à un risque d’isolement, les relations de voisinage jouent un rôle crucial. L’attachement au logement et au quartier repose sur un sentiment de partager un espace d’expériences communes et permet aux habitants de se reconnaître et d’être reconnus. En ce sens, le quartier peut être vu comme un lieu de construction d’une communauté. Même ténus, les rapports construits de longue date avec les voisins favorisent un sentiment d’appartenance et d’interconnaissance. Une majorité des personnes interrogées (74%) déclarent entretenir des contacts étroits avec leurs voisins et près d’un quart d’entre elles aspirent à plus de liens. Si ces contacts sont généralement appréciés, ils revêtent une importance particulière pour les plus fragiles : ainsi plus de la moitié des personnes âgées de plus de 85 ans, et à plus forte raison celles qui ont des problèmes de santé, considèrent ce soutien comme une ressource indispensable au quotidien. Face à l’augmentation des personnes vivant seules, ces relations de proximité s’avéreront centrales à l’avenir. Les solidarités de quartier peuvent être favorisées par le déploiement de réseaux de soutien ou de « caring communities » ; des actions qui nécessitent une réorientation des prestations, ainsi qu’un renforcement des compétences de l’intervention professionnelle vers l’accompagnement social avant tout. Le rôle des référentes sociales dans les logements accompagnés ou des coordinateurs de quartiers en sont de bons exemples.
D’après le Age Report V, Habiter, vieillir et voisiner. V. Hugentobler & A. Seifert (dir.), 2024.